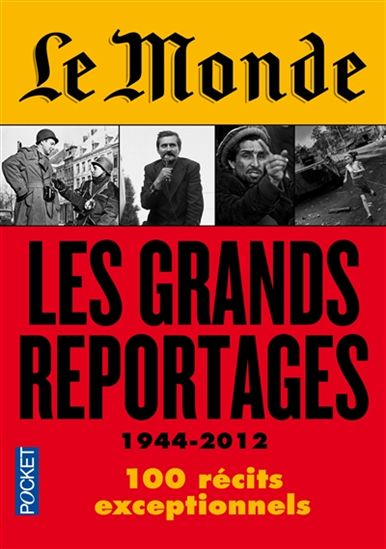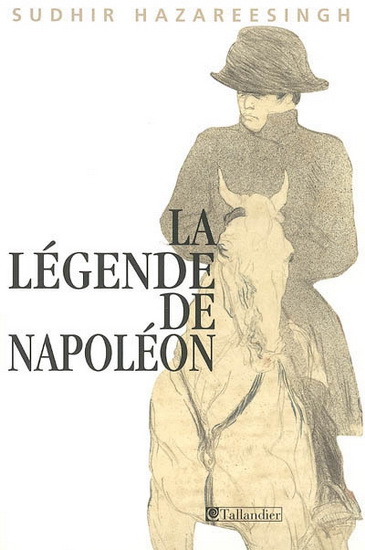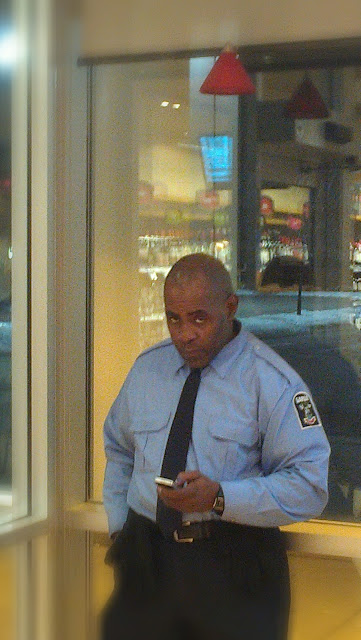Samedi de congé. Il fait «beau». Beau dans le sens «soleil». Il fait quand même dans les - 12 000° quelque chose. Du coup, je glande dans la maison avec un immense sentiment de culpabilité. Il fait soleil merde, je dois au moins sortir.
Sortir?
Oui, mais pour faire quoi?
Certes, c’est plus chaud que les dernières journées, mais en regardant le site de météo Canada, je vois que ça chatouille tout de même les -20°. Remarquez que je pourrais aller patiner et me taper quelques shots sur la bande de la patinoire du parc d’à côté. Mais l’effort à mettre me décourage. Et puis je n’ai pas envie d’avoir froid, de me geler les mains, de sentir le bout des orteils me picoter, de patiner contre le vent et de voir ainsi le froid se multiplier par 2 juste par mon accélération exceptionnelle, dit-il en se grattant la poche.
Oui, mais il fait «beau»!
Bon, je vais aller m’acheter de la bouffe. Ça fera déjà ça comme sortie. Sorte de compromis en joignant l’utile au désagréable froid. Comme j’ai un budget très serré en ce moment, je me fixe un montant maximal. Ça sera $50 max. Bien assez pour me faire l’épicerie de la semaine et de me préparer mes lunchs jusqu’à vendredi prochain. Au menu, sauce à spag et ragoût de boeuf. Avec ça et deux ou trois couscous de dernière minute, je peux facilement combler tous mes repas de la semaine.
C’est bon, c’est décidé, c’est ce que je vais faire.
Mais je me prépare un plan de sortie, question de profiter au maximum de la journée. Je vais marcher hyper rapide jusqu’à la caisse pop de la rue Berri pour y déposer un chèque au guichet, puis je descendrai un peu au Sud jusqu’à la librairie Renaud-Bray sur St-Denis pour me réchauffer. Ensuite, retour à la maison en arrêtant ici et là pour acheter ma bouffe.
Bonne idée.
J’aime.
J’enfile mes peluches d’hiver et je teste pour la première fois la paire de gants laissée sur le comptoir par un client étourdi et qui n’est jamais venu les rechercher. Gants de qualité A1 hyper isolés. Mais je n’ai pas eu le temps de les laver et ils sentent le parfum cheapo. Et si ça se trouve, le mec, il s’est gratté le cul avec son index avant d’enfiler ses gants. Oui bon, ne pas penser à ça. Et puis ça ne peut pas être pire que de manger dans la vaisselle douteuse d’un chalet de pêche. Et puis je me laverai les mains en revenant.
Je sors.
Fuck, j’ai le vent en plein dans la face et j’ai la désagréable sensation que mes cuisses se font mordre par la Nordique bise. C’est franchement désagréable et j’accélère le pas. Je marche rapidement, me frayant un chemin entre les branleux emmitouflés qui marchent pépère sur un trottoir pas assez déneigé. Mon manteau est chaud, mais comme il est ample au niveau de la taille, le froid s’infiltre vicieusement à l’intérieur en grafignant mon ventre au passage.
Je trouve l’exercice désagréable au possible. Je n’aime pas ça. Je n’aime plus l’hiver. Je la supporte parce que je suis bien obligé.
Je marche donc encore plus rapidement en rêvant du jour où j’obtiendrai ma nationalité marocaine pour les périodes allant de novembre à mars.
J’arrive au guichet. Il fait chaud, il fait bon. Tous les guichets sont occupés. J’attends en file. Derrière moi, trois Amérindiens sans abris occupent un recoin avec leurs couvertures et leurs sacs à dos. L’un d’eux roupille. Je trouve l’image immensément symbolique. Dans un réduit chauffé d’un guichet automatique appartenant à une grande institution bancaire, trois autochtones recroquevillés et démunis de tout se préservent du froid sibérien. Ils regardent impassibles des blancs retirer des billets de banque. Je quitte les lieux avec une partie de mon fric déposé et l’autre partie dans mes poches. Je détourne le regard quand l’un des trois Amérindiens me tend la main.
Je me dégoûte trois secondes. À la quatrième seconde, je n’y pense plus.
Renaud Bray. Ma deuxième maison l’hiver à Montréal. Je ne vais pas acheter, je vais juste regarder. Promis! Je le jure sur ma tête! Mais déjà, mon oeil est attiré par un ouvrage qui fait 950 pages. Une petite brique éditée par le journal Le Monde. Le titre : Les Grands Reportages 1944-2012.
Fuck... je regarde le prix : $25,95. Je feuillette, je bave, je jubile, je bande, mais je repose. Je n’achèterai rien. Je le jure!
Je monte à l’étage au département de l’Histoire. Je trouve :
* La légende de Napoléon (Tallandier) par Sudhir Hazareesingh.
Résumé : L’historien s’intéresse, dans cet ouvrage, à la construction de la mémoire napoléonienne. L’auteur a étudié les archives nationales et locales pour y retrouver les traces de la popularité de Napoléon, un phénomène qui a forgé la culture politique française.
Ça j’adore. La construction d’un mythe. Comment ça marche? Comment ça devient une divinité? Par quel cheminement social? Comment saisir l’insaisissable? Napoléon homme de guerre et Napoléon homme de paix. Napoléon dictateur et Napoléon démocrate. Napoléon qui rétablit l’esclavage et Napoléon qui libère les Juifs de l’île de Malte. Napoléon qui envoie la jeunesse française à l’abattoir et Napoléon adulé par cette même jeunesse française. Comment le situer? Comment l’analyser? Comment le comprendre? Justement, après plus de 200 livres lus, je n’y arrive pas encore. Une source intarissable de fascination. L’ambiguïté humaine à son paroxysme. Comme si Dieu et Diable avaient fait un pacte. «Créons un humain à 50% de nous-mêmes»
- Le combat de deux Empires (Fayard) par Oleg Sokolov, un historien Russe qui m’avait fait littéralement capoter dans la revue Napoléon 1er par ses articles sur la campagne de Russie. Un point de vue russe autre que celui du pédant Tolstoï sur Napoléon.
Résumé : Ce livre expose les causes réelles de la campagne de Russie, les véritables motivations politiques, les plans stratégiques des deux camps et présente un vaste tableau de l’état d’esprit des sociétés russe et française. Il s’appuie sur des rapports, des journaux, des lettres ainsi que sur la presse et la littérature de l’époque à travers des documents russes, français et polonais.
Un livre didactique. À ne pas mettre dans les mains d’un profane qui voudrait se familiariser avec l’époque. Mais j’aime cet historien. Un cerveau le mec. Des faits, des faits et encore des faits. Pas d’approximation, pas de coins tournés rondement, pas de jugement, mais que des faits. Le genre à passer trois ans à dépatouiller des archives pour écrire un seul paragraphe.
* Napoléon chef de guerre (Tallandier) par Jean Tulard. Bon, en ce moment, Jean Tulard est LA référence française pour Napoléon, comme l’ont été Frédéric Masson, Louis Madelin et jusqu’à un certain point, André Castelot à leur époque respective. Jean Tulard est vieillissant et son dauphin est Thierry Lentz, plus jeune, mais tout aussi conformiste. Ils sont copains-copains et réfutent en équipe la thèse de l’empoisonnement de Napoléon à Ste-Hélène malgré les preuves scientifiques amenées par les spécialistes de la CIA et du FBI. Le genre d’historien à l’ancienne qui exècre l’idée qu’un autre corps de métier vienne mettre ses pattes sales (et étrangères à la nation) dans leurs champs de compétence. Chasse gardée! Sont obtus, mais sont tout de même compétents quand ils abordent un sujet autre que l’empoisonnement.
Résumé: Un portrait biographique de Napoléon sous l’angle militaire, à travers l’évocation de son charisme dans ses relations avec les officiers et le fonctionnement de l’armée.
Autre sujet pour névrosé de mon genre.
Je tourne en rond dans la boutique. Le combat des deux Empires me tente, mais ça se vend à 40 balles. Il ne me resterait que 10$ pour mon épicerie. Des nouilles? Du riz? Du couscous pour toute la semaine? Fuck... je dois prendre une décision. Et si j’allais du côté des romans en format poche? J’y vais, je glandouille, je ne trouve rien qui m’intéresse. J’ai soif de champs de bataille, je veux lire sur de types qui meurent transpercés par des baïonnettes et qui crient «Vive l’Empereur» avant de s’éteindre. Comment il est arrivé à ça Napoléon? Comment tu peux avoir le bide ouvert et voir tes tripes prendre du soleil et quand même être capable de te lever sur tes deux pattes pour saluer l’Empereur qui passe sur le champ de bataille? Comment? Je délaisse les putains de romans et je retourne dans la section histoire. Je reprends les trois mêmes livres dans mes mains et j’ai pour chacun une profonde envie. Mais j’ai juré de ne rien acheter. Je dépose les bouquins sur leur tablette et je me casse presque en courant pour mieux résister. Je redescends les escaliers, je viens pour sortir, mais à la dernière minute, je reviens sur mes pas et je prends sur le présentoir «Les Grands Reportages» du journal le Monde.
Fuck off. La simplicité volontaire, je veux bien, mais pas pour le cerveau. J’ai autant besoin de livres que de nourriture. Ce n’est pas de ma faute, j’en ai manqué quand j’étais petit. Sauf pour les BD. Heureusement.
À la caisse, la fille est une Française. En fait, toutes les personnes que je croise sur le Plateau sont maintenant Français. Y en a en tabarnak. C’est une véritable invasion. À croire que toute l’émigration française habite entre St-Laurent et Iberville et entre St-Joseph et Sherbrooke. L’explosion des loyers, c’est de leur faute. Mais ça ne me dérange pas. J’adore les Français et je suis bien content qu’ils viennent s’installer ici. Ça nous donne de bons restaurants en ville et quand ils vont s’établir en campagne, ça nous donne de très bons fromages. Et puis ils ne sont plus aussi chiants que ceux qui sont venus s’installer dans les années ’50 et ’60. Sont plus à gauche, moins colonialistes, plus carré rouge que carré vert.
Enfin, je me comprends.
Je sors du Renaud-Bray. Un type devant la porte, toujours le même, me tends la main pour que je lui dépose une pièce de monnaie. Je fais mine de ne pas le voir. Je me dégoûte pendant trois secondes, mais à la quatrième, je n’y pense même plus. Je reprends le chemin inverse, mais cette fois, j’ai le vent dans le dos et c’est plus supportable.
Je pense à mon épicerie. Je viens de balancer 25$ sur mon budget de 50$. Bon, je mangerai plus de légumes. J’arrête chez Valmont. Je fais le plein de machins qui poussent avec du vert. Et puis des tomates. Et puis du couscous. Je vais en avoir besoin. C’est bon du couscous. Ça ne coûte rien quand t’achètes les gros formats et tu peux y foutre tout ce que tu veux dessus. Légumes, viandes, et même ketchup-maison de ma mère quand il n’y a que ça. C’est délicieux. Ça dépanne comme on dit. Il me reste encore une demi-bouteille de mon huile d’olive marocaine. Couscous, tomates coupées finement, oignons coupés finement aussi, sel, poivre, huile d’olives, t’es en business mec. Ne pas oublier les quelques gouttes de jus de citron. Tu te fais une grosse plâtrée le matin et t’es bon pour toute la journée. Ça te fait tes deux lunchs pour le boulot et tu peux lire tes Grands Reportages du journal le Monde à $25 sans te sentir coupable.
En tout cas, c’est comme ça que je vois la vie quand il fait - 344 912 096° au soleil et que t’es encore très loin de ton premier lancer pour la pêche à la truite.
Je reviens à la maison et je me tape tout de suite la salade pour la semaine. Je la passe à l’eau, je la coupe très très très finement et je la dépose dans le frigo. Quand je me tape des journées de 12 heures au boulot, j’ai réalisé que pour les supporter, il faut des lunchs consistants avec des fruits et des légumes en complément. Pour les fruits, ça va. Je me gave de bananes au Nutella le matin. Recette facile. Je vous montre :
Prendre 4 tranches de pain. Les écraser préalablement avec une spatule avant de les mettre au grille-pain parce qu’elles sont toujours trop épaisses et que ça coince dans le grille-pain et que c’est très chiant de les retirer ensuite. Ça casse en mille morceaux. Quand tu les écrases bien comme il faut avec une spatule, ça fait comme une galette de pain très mince. Tu crisses ça dans le grille-pain. Pendant ce temps-là, tu te coupes une banane en 2 000 rondelles. T’attends que ton pain soit grillé. Quand c’est fait, tu câlisses sur ton pain une couche de beurre non salé. Tu déposes tes rondelles de bananes sur ton pain grillé et ensuite tu recouvres le tout d’une épaisse louche de Nutella jusqu’à ce que ça déborde. Tu refermes le tout avec l’autre tranche de pain de manière à te faire un sandwich. Tu coupes ça en 4 et tu bouffes en lisant Foglia dans La Presse ou Jean Dion dans Le Devoir. Ça te fait un petit paradis pour pas cher.
Enfin bref.
Le soir, j’ai une bière de prévue avec M... On se donne rendez-vous au bar resto le Brouhaha sur De Lorimier. Ça fait depuis octobre qu’on ne s’est pas vu. C’est pas croyable. Le temps passe si vite ici-bas.
Elle est toujours aussi belle. On se prend une bière en apéro. Moi une blanche et elle une Pilsner. On a des tas de trucs à se dire. C’est ça qui est chouette de ne pas former un couple tout en restant toujours proches l’un de l’autre. On est toujours contents de se voir et on a toujours de tas de trucs à se dire. On ne s’engueule jamais, on n’est jamais blasé de se voir, on est toujours heureux de se retrouver, on se drague forcément toujours un peu. J’ai même fait attention à mon habillement avant d’aller la rejoindre. C’est tout dire. J’allais la retrouver avec un pantalon qui me faisait le cul comme une poche de patates. Franchement! Elle ne mérite pas ça. À la dernière minute, je me suis fait le ballet des essayages et j’ai opté pour mon pantalon noir hyper chic mais pas trop, genre L’Aubainerie à $15. Neuf. Ce qui est pour moi une dépense inconsidérée. Mais dans ce pantalon, j’ai un cul pas pire malgré mes presque 50 ans. Genre fesses assez rondes avec une coupe au niveau des jambes qui met en valeur ma gestuelle bohémienne, même si je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J’ai enfilé un t-shirt noir très serré pour masquer une certaine musculation un peu déficiente et j’ai camouflé la rondeur naissante de mon bas de poitrine par une chemise scientifiquement boutonnée aux deux premiers boutons du bas. De sorte que ma poitrine ouverte offrait à ses yeux mon noir t-shirt serré et que le reste était savamment recouvert par ma chemise à motifs un peu hippies. Jeune de corps et de coeur, comme ils disent dans les reportages à la radio.
On s’est parlé de nos trucs de vieux. Moi et mes problèmes de vision, elle et ses problèmes de colonne vertébrale à force d’écrire des machins très chiants sur son ordi. Massage et chiro, yoga et j’sais pas quoi. Elle dit souvent «nous sommes rendus à l’âge de la restauration. Faut l’accepter." Moi, je ne suis pas encore passé par l’acceptation. Ça viendra sûrement, mais en attendant, j’ai encore un bout d’espoir que ce vieillissement-là, ben merde, il finira par cesser de lui-même. Ce qui me fait penser à cette cliente, une sympathique dame de 65 ans qui vient une fois par semaine pour acheter sa bouteille de Martini qu’elle tète ensuite pendant 7 jours. Elle en est à sa deuxième transplantation cardiaque. Elle en aurait besoin d’une troisième. Mais elle vient de décider que c’est terminé, qu’il n’y en aura pas une troisième. «J’ai eu deux chances incroyables dans ma vie. C’est assez. J’ai dit à mon docteur que le prochain coeur disponible, il faut le donner à un patient plus jeune que moi. J’ai porté en moi deux coeurs qui avaient appartenu à deux jeunes personnes. C’est assez. Je dois maintenant céder ma place. Ça serait du gaspillage sinon. Tiens, et si c’était ta fille qui en aurait besoin?»
Tu réponds quoi à une dame qui te dit ça?
Rien justement. Il n’y a rien à dire.
On se commande notre bouffe. J’opte pour l’assiette de smoked meat et elle pour les côtes levées. Mon plat arrive bien avant le sien et comme elle a faim, elle pioche dedans. D’abord en me piquant subrepticement quelques frites, puis ensuite en mordant carrément dans mon smoked meat. Je te refilerai de mes côtes levées, qu’elle me dit pour se faire pardonner. Mais je lui pardonne déjà, avec ou sans côtes levées. On pardonne tout à une fille qu’on fréquente éternellement sans jamais s’engager. C’est pour ça que ça dur aussi longtemps ce genre d’histoire d’amour qui n’en est pas une, mais qui en est une quand même sans réellement en être une. Si ça faisait 10 ans que nous formerions un couple, l’idée de la voir bouffer mon smoked meat m’aurait agacé. Voire énervé. Mais là, comme ça, bof, c’est rigolo. Ça fait partie de son charme. Charme qui d’ailleurs ne meurt jamais puisque je ne la vois pas tous les jours.
Voyez comment c’est subtil la vie.
Non, vous ne voyez pas?
Après ça, on a été chez elle et comme j’étais un peu crevé, j’ai pris un café qu’elle m’a fait sans cramer sa cafetière. Faut dire qu’elle est championne dans l’art d’oublier des machins sur le feu. Pendant que je buvais mon café, elle s’est versé une larme de Whisky. Du Grant pour être plus précis. Finalement, j’en ai pris aussi. On ne crache pas là-dessus.
Lendemain dimanche, j’étais prêt pour le grand ménage de la maison. Je me préparais à cette tâche depuis des semaines. Finalement, après avoir lavé la vaisselle, je me suis écrasé dans le sofa pour lire mes grands reportages du journal Le Monde. La poussière et moi, on est très potes finalement. On s’endure mutuellement. C’est mieux qu’un animal de compagnie. Quand ça devient des moutons, c’est plus silencieux qu’un chien et ça ne décriss pas les tissus des sofas comme un chat. Tu peux même les prendre dans tes bras et les caresser quand t’as envie d’un peu d’affection.
Bon, je sens que je vais bientôt verser dans les conneries. J’arrête ici.